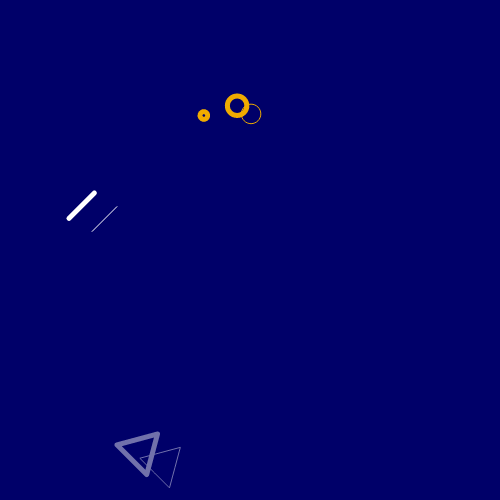
Laurent de Saint-Léger
Contributeur libre du CAPExpert national détaché dans les institutions européennes. Il a publié « la France dans le piège de l’euro » aux Éditions Vérone en 2019.
Depuis la fin des années 1970, le poids de la dette publique de la France grossit inexorablement, la pandémie actuelle n’ayant fait qu’accélérer cette tendance. Loin de préparer la croissance économique de demain, cette dette ne fait que financer un vaste système de redistribution dont l’efficacité est de plus en plus sujette à caution. Or, plutôt que de réfléchir aux moyens d’assainir durablement la situation budgétaire du pays, le débat semble se focaliser sur les moyens pour ne pas rembourser cette dette. Les solutions envisagées : annulation de la dette détenue par la BCE, cantonnement ou dette perpétuelle, sont largement irréalistes car elles oublient qu’une restructuration de la dette publique française nécessitera obligatoirement un accord des créanciers qui demanderont forcément des contreparties pour prévenir nos dérives budgétaires à l’avenir. Ce qui guette la France si elle persiste dans son insouciance sur la dette publique, c’est le scénario que vit la Grèce depuis 2010 : des programmes d’ajustement sous l’égide du FMI et des institutions européennes qui entraîneront un appauvrissement marqué de la population.
Il est certain qu’au fur et à mesure que l’échéance de l’élection présidentielle de 2022 se rapprochera, le débat sur la façon de traiter la dette publique de la France va gagner en ampleur. Aujourd’hui, personne ne peut contester que celle-ci atteint un poids inquiétant risquant de compromettre les capacités de reprise économique après la fin de la pandémie. La dette publique de la France représentait plus de 120% du PIB fin 2020, alors qu’elle ne dépassait pas 20% du PIB au début des années 1980. Et encore, ce chiffre officiel ne recouvre pas toutes les dettes dites contingentes comme les engagements des systèmes de retraite, la dette des entreprises publiques (SNCF, EDF, etc.) ou encore les prêts garantis par l’état (PGE) dont une partie risque de n’être jamais remboursée par les entreprises confrontées à la crise actuelle.

Depuis la fin des années 1970, la hausse du poids de la dette est intervenue par palier, avec une forte accélération durant les phases de crise (1993, 2008 et 2020) et une stabilisation toute relative durant les périodes économiques plus favorables. Ceci illustre l’insouciance des gouvernements de droite comme de gauche qui ont toujours privilégié leurs promesses de baisse des impôts et de nouvelles dépenses sociales à l’apurement des dettes. Un « après moi le déluge » consistant à signer des traités sur le futur pour financer des besoins immédiats.
Si encore ce recours à la dette avait permis de préparer l’avenir et de renforcer le potentiel de croissance, le choix fait par la France aurait pu être vu comme judicieux. Sauf que le bilan des 40 dernières années est proprement désastreux pour notre pays, comme l’atteste un phénomène de désindustrialisation beaucoup plus marqué que chez nos voisins (un déficit commercial de 84 milliards d’euros en 2020 alors que l’Allemagne enregistre dans le même temps un excédent de 183 milliards et l’Italie 64 milliards), un recul manifeste dans le domaine de la recherche (l’incapacité à développer un vaccin face au Covid-19 en est la preuve la plus éclatante) ou encore l’effondrement de notre système éducatif, de plus en plus mal classé au niveau mondial par les enquêtes Pisa de l’OCDE. La dette publique n’a fait que financer une protection sociale de plus en plus obèse – la France est au premier rang européen, devant la Suède ou le Danemark, pour le niveau de redistribution – tout en compensant de façon de plus en plus imparfaite les conséquences de notre affaiblissement économique (chômage de masse et montée de la pauvreté).
La France est droguée à l’argent public et rien d’étonnant, dans un tel contexte, de voir combien la préoccupation d’avoir à rembourser un jour la dette soit mise au second plan. Le discours sur le « quoi qu’il en coûte », repris par la plupart des forces politiques, et les demandes répétées d’une annulation de la dette, font qu’il s’est instillé dans la population française l’idée que financer à crédit les dépenses publiques n’était pas un problème. Dans un pays où près du quart de la population active est dans la fonction publique et où les retraités représentent un tiers du corps électoral, on imagine mal un gouvernement mettre en œuvre les efforts gigantesques de rigueur budgétaire (hausse des prélèvements et coupes drastiques dans l’état providence) qui permettraient de rompre avec cette spirale de l’endettement apparemment indolore. Tout parti politique qui ferait campagne sur un tel programme serait assuré de perdre.
Mais si le laxisme en matière de dette reste l’opinion la plus répandue, le principe de réalité s’impose et, pour paraphraser Keynes, « les arbres ne montent pas jusqu’au ciel ». La dette ne peut pas augmenter indéfiniment et il y aura forcément un seuil au-delà duquel les créanciers de la France vont dire « stop ». Pourtant, comme la rigueur budgétaire est un sujet devenu complètement tabou, les seules propositions actuellement sur la table cherchent plutôt à contourner le problème : trouver une solution pour ne pas avoir à rembourser cette dette !
- D’abord les partisans d’une annulation pure et simple de la part de la dette publique détenue par la BCE et la Banque de France (environ 25% de la dette totale). C’est le sens de la tribune publiée le 5 février et signée par plus d’une centaine d’économistes de gauche menés par Thomas Piketty. L’argument principal est que cette annulation ne coûterait rien[1] et qu’elle permettrait de redonner des marges budgétaires pour « faciliter la reconstruction sociale et écologique après la pandémie de Covid-19 ».
- Ensuite la solution préconisée par le Haut-commissaire au Plan, François Bayrou, d’un cantonnement de la dette Covid (estimée à environ 20% du total). Le remboursement de celle-ci serait reporté entre 2030 et 2060 et les marges budgétaires ainsi libérées permettraient de financer un grand plan de relance de 250 milliards d’euros.
- Une dernière proposition est celle d’une dette perpétuelle, reprise dans une tribune de Georges Soros dans Les Echos du 3 mars. Émettre des titres qui auraient une durée de vie illimitée et porteraient un taux d’intérêt minimum.
Notons que, dans toutes ces idées, il n’est jamais question de revenir à une situation budgétaire assainie mais au contraire de pouvoir financer de nouvelles dépenses qui ont toutes chances d’être génératrices d’une nouvelle dette dans l’avenir. Voilà qui ne risque guère de rassurer des créanciers à qui nous demandons d’accepter la pilule d’une annulation, d’un rééchelonnement, ou d’une dette jamais remboursée.
Mais le plus grave est que ces demandes n’ont guère de chance d’aboutir dans le contexte actuel et qu’elles servent surtout à rehausser la visibilité de leurs initiateurs. S’agissant de l’annulation de la dette portée par la BCE, sa Présidente Christine Lagarde a immédiatement répondu que c’était inenvisageable car constituant une violation des traités européens qui interdisent le financement monétaire des pays-membres. L’Allemagne et les autres pays d’Europe du Nord (Pays-Bas, Autriche, Finlande) ne pourraient jamais accepter une mesure allant directement à l’encontre du dogme maastrichtien de la stricte séparation entre les politiques budgétaires nationales et la politique monétaire unique. De surcroît, cette annulation pourrait entraîner une grave perte de confiance dans la capacité de la banque centrale à lutter contre l’inflation. En ce qui concerne le cantonnement de la dette Covid, celui-ci ne peut être fait de manière unilatérale. Il faudrait forcément en passer par une renégociation des conditions de la dette déjà émise : soit une restructuration qui nécessitera un accord des créanciers. Pour ce qui est d’une dette perpétuelle, cette idée ne vaut que pour les titres que l’on commencerait à émettre aujourd’hui : pas la dette déjà accumulée sauf à renégocier ses conditions, ce qui nécessite comme pour le cantonnement de passer par une restructuration. Enfin, pour que de tels titres jamais remboursés puissent trouver preneurs, il faudrait une rémunération suffisamment attractive pour les créanciers, certainement plus élevée que pour les titres actuels.
Toutes ces propositions partagent un oubli : la France ne peut plus décider toute seule ce qu’elle va faire avec sa dette. C’était encore possible jusqu’au milieu du 20ème siècle quand la dette était financée par des petits rentiers venant placer leur pécule en achetant des bons au porteur dans les trésoreries de l’état ou par le biais de grands emprunts (Pinay, Giscard) lancés auprès du public. Mais depuis la révolution financière des années 1980, la dette publique est à 100% émise sur les marchés internationaux. Les particuliers français n’ont plus accès à cette forme de placement, sauf par l’intermédiaire de leurs fonds en « assurance-vie ». L’essentiel de la dette publique est aujourd’hui détenu par les banques centrales, les banques, les compagnies d’assurance et les fonds de pension, avec une partie significative (estimée entre 30 et 40%) dans les mains d’acteurs étrangers. Les émissions sur les marchés internationaux doivent respecter un certain nombre de règles qui visent à protéger les droits des créanciers. C’est le système des clauses d’action collective : pour qu’un emprunteur puisse restructurer sa dette, il doit obtenir un accord des créanciers possédant au minimum 75% de l’encours. Cet accord sera alors appliqué à l’ensemble des détenteurs de titres, évitant ainsi des restructurations partielles. Les créanciers majoritaires sont ainsi en position de force pour imposer leurs propres conditions, tant aux créanciers minoritaires que vis-à-vis du pays emprunteur.
Le dernier facteur alimentant l’insouciance française sur la dette est l’intervention de la BCE qui, depuis le début de la pandémie, s’est lancée dans un programme quasiment illimité de rachat des titres de la dette publique des pays de la zone euro sur le marché. En 2020, la banque centrale a ainsi financé par ce biais l’intégralité de la hausse du déficit public français : soit la bagatelle de 150 milliards €. Et ce soutien sera poursuivi en 2021 avec des achats nets programmés à 300 milliards € en 2021. Avec un tel bouclier, la France n’a pas à craindre d’attaque spéculative à court terme sur sa dette. La rançon est que nous sommes entièrement dépendants de la BCE qui peut décider de ralentir ou même interrompre ses achats à tout moment. Rappelons en effet – encore un sujet sur lequel nos politiques se gardent de s’étendre – que cette institution n’agit pas sous le contrôle du gouvernement français, à l’instar de ce qu’est la Banque d’Angleterre pour le gouvernement britannique. Nous ne disposons que d’un siège au conseil des gouverneurs, en même temps que les 18 autres pays composant la zone euro. De ce fait, nous ne sommes pas à l’abri d’un changement d’orientation de la politique de la BCE, en raison d’une résurgence de l’inflation ou parce que les Allemands commenceraient à prendre peur devant cette mutualisation qui ne dit pas son nom des dettes publiques dans la zone euro.
Que peut-il donc se passer ? À court terme, probablement rien. Nous allons continuer à assister au gonflement de la dette publique, bercés par les discours rassurants des politiques et protégés par l’assurance tout risque du programme de rachat de la BCE. À moyen terme, les choses sont quelque peu différentes. D’abord parce qu’il est impossible pour la BCE d’augmenter indéfiniment sa part de dette publique détenue en portefeuille. Ce serait l’aveu que la crise a un caractère structurel et que la banque centrale n’agit plus que pour régler les fins de mois des pays les plus endettés, au risque de ne plus être en mesure de respecter son mandat de défense de la stabilité des prix. Les pays vertueux comme l’Allemagne ne pourront accepter cette dérive contraire aux Traités européens. La BCE devra forcément un jour stopper sa politique d’achat inconditionnel de la dette publique car c’est in-fine la survie de la monnaie unique qui est en jeu.
La vraie question est donc plutôt de savoir à quel horizon le réveil pour notre pays peut survenir pour sonner le glas de notre insouciance sur la dette. Comme disait l’écrivain Céline, « on ne meurt pas de dette mais de ne plus pouvoir faire de dette ». La France étant aujourd’hui totalement dépendante de ses créanciers, tout mouvement de défiance de leur part produirait des conséquences immédiates et catastrophiques. La disparition des acheteurs sur notre dette se traduirait alors par une remontée en flèche des taux obligataires qui ne manquera pas de toucher l’ensemble des autres emprunteurs français.
Sur le risque de survenance d’une telle crise, deux types d’événements sont à surveiller.
- D’abord, un changement de l’environnement économique mondial avec une remontée générale de l’inflation, provoquée par exemple par une hausse du prix du pétrole et des matières premières, des pressions sur les coûts des importations en provenance de Chine, ou encore des tensions protectionnistes. Pour rester fidèle à son mandat, la BCE n’aurait d’autre choix que de remonter ses taux directeurs ce qui se répercutera à plus ou moins brève échéance sur la charge de la dette publique. À titre d’illustration, si le taux moyen sur la dette augmentait de 2%, la France devrait payer 50 milliards d’euros en plus par an à ses créanciers. La seule solution pour éviter la banqueroute serait alors de demander à la BCE d’accroître encore ses rachats de titres, un scénario évidemment impossible à accepter pour la banque centrale car ce serait donner d’une main ce que l’on a repris de l’autre.
- Ensuite, un changement de nature politique en Europe qui serait synonyme d’une remontée du sentiment de risque pour les investisseurs. Soit une crise politique dans les grands pays les plus endettés (l’Espagne, l’Italie et bien sûr la France), soit un gouvernement allemand moins conciliant envers le laxisme budgétaire pratiqué par certains pays-membres. De ce point de vue, une importante séquence va s’ouvrir à l’automne 2021 avec les élections fédérales en Allemagne, qui sera suivie six mois plus tard par l’élection présidentielle en France, et avec de surcroît une forte probabilité d’élections anticipées sur la même période en Italie et en Espagne.
Quand la crise se déclenchera, laissant la France incapable de continuer à refinancer sa dette sur les marchés, quel sera le moyen d’en sortir ? Compte tenu de la taille de notre pays, ce sera une crise d’importance systémique pour la zone euro. Pour autant, il serait illusoire d’espérer que la BCE et les institutions bruxelloises viendront à notre secours « quoi qu’il en coûte », pour reprendre l’expression présidentielle utilisée depuis le début de la pandémie. Un bailing out inconditionnel signifierait en effet la mort de la monnaie unique car beaucoup de pays-membres ne pourront accepter de financer notre modèle social si dispendieux et bien plus généreux que le leur. La France sera alors forcée d’en passer par un scénario à la grecque. En échange d’une restructuration de notre dette publique pouvant comporter des allongements d’échéance, des réductions d’intérêt et même une annulation d’une partie de l’encours, les créanciers exigeront un programme d’ajustement économique visant à garantir que nous mettions fin durablement à notre déficit public : c’est-à-dire des hausses d’impôt et des privatisations, mais surtout une baisse des dépenses essentiellement sociales. Si l’on suit encore l’exemple grec, ce programme d’ajustement, établi sous l’égide conjointe du FMI et des institutions européennes (les fameuses troïkas), risque de viser en premier lieu nos dépenses de retraite et notre fonction publique hypertrophiée.
Inutile de préciser qu’un tel scénario touchant les deux populations qui ont jusqu’à maintenant largement été immunisées contre les effets de la crise – les fonctionnaires et les retraités – aura des conséquences politiques catastrophiques. Un gouvernement ne pourrait s’y résoudre que contraint et forcé, sous la menace d’une sortie de la zone euro notamment. Quant à l’acceptabilité du programme d’ajustement par les Français, c’est aussi une question ouverte. Même en utilisant la démagogie de faire payer les riches, le poids de la rigueur budgétaire pèsera d’abord et avant tout sur la classe moyenne. Tous les programmes d’ajustement sous l’égide du FMI se sont traduits par un nivellement par le bas, la classe moyenne rejoignant les plus pauvres et seuls quelques très riches (ceux qui peuvent replacer leurs avoirs à l’étranger) arrivant à se protéger.
Il n’est peut-être pas encore trop tard pour éviter ce scénario catastrophe mais encore faudrait-il un effort collectif pour sortir de l’insouciance actuelle. D’abord tordre le cou aux fausses solutions de facilité en ne laissant plus croire qu’on peut sans dommage décider de ne pas rembourser notre dette. Ensuite, que notre personnel politique ne s’enferme plus dans une vision réductrice limitée au court terme. On peut peut-être espérer vivre encore quelques années avec cette dette publique qui gonfle régulièrement, car la France reste considérée comme un pays riche et nous gardons l’image d’un émetteur qui n’a jamais fait défaut sur sa dette depuis la Révolution française. À moyen terme, la froide réalité des chiffres ne peut que s’imposer et notre pays n’obtiendra aucun traitement de faveur de ses créanciers. Comme pour la Grèce, la solidarité européenne devra être payée comptant, en étant contraint d’accepter des réformes économiques et sociales décidées de l’extérieur qui risquent de se traduire par un appauvrissement pour la plupart des Français. Sur la dette publique, un langage de vérité est aujourd’hui indispensable.
> Télécharger en PDF ici <<
Merci !
L’article est déverouillé. Bonne lecture !
[1] Parce qu’une banque centrale peut supporter toutes les pertes du fait que c’est elle qui crée la monnaie. De surcroît, l’annulation de la dette détenue par la banque centrale n’impacterait pas les autres détenteurs de la dette.




